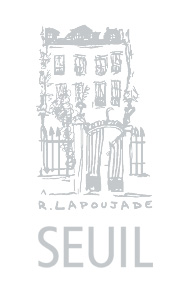Actes de la recherche en sciences sociales, n° 256. Écologie et dominations II.
Mobilisations sociales et recompositions des rapports de classe
Après avoir exposé (dans le numéro 255) l’intérêt de la notion de condition écologique des classes sociales pour étudier les rapports de domination à l’œuvre en matière d’environnement, ce numéro s’attache plus spécifiquement à la mobilisation de différents groupes sociaux face à des contaminations diverses (minières, industrielles) et aux enjeux professionnels liés à l’écologisation de leurs domaines d’activité. Dans quelle mesure les nuisances environnementales et les luttes sociales qu’elles génèrent favorisent-elles la recomposition des conflits de classe ?
Les cas des boues rouges de Gardanne comme celui des pollutions métalliques de la mine de Rio Tinto en Andalousie révèlent comment l’engagement écologique des milieux populaires peut être mis à l’épreuve par l’activité extractive et la gestion des résidus. De même, des projets d’agriculture urbaine encouragés par la « rénovation écologique » des quartiers permettent à des associations écologiques de mobiliser les classes populaires contre la dépossession de leurs lieux de vie. Cette mobilisation se fait au prix de l’imposition de pratiques écologiques issues des classes moyennes cultivées, parfois désajustées à leur mode de vie. D’autres secteurs non industriels et non urbains sont aussi touchés par ces transformations. L’évolution du métier de gardien de troupeaux en alpage vers une activité de protection des espaces naturels disqualifie ainsi le travail des anciens bergers face aux pratiques portées par une petite bourgeoisie culturelle en reconversion. Enfin, la diffusion de pratiques gestionnaires du sanglier dans les forêts françaises produit une exclusion des « petites chasses » populaires, sous la pression des « grandes chasses » bourgeoises, corrélatives d’une appropriation des lieux, des ressources et des usages par les classes dominantes.
Actes de la recherche …
Collection : Actes de la recherche en sciences sociales
Format : Broché
Pages : 112
EAN : 9782021588743 19.00 € TTC